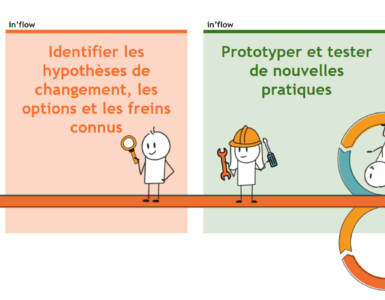Le Cigref fait parler de lui ces derniers jours en choisissant Clearvale (solution américaine) sans consulter aucun éditeur français équivalent. Une maladresse, qui en dehors de ce cas particulier, sert de révélateur à une situation plus générale en passe de tuer le marché français des éditeurs RSE.
L‘émoi des éditeurs français est compréhensible, comme toujours face à une distorsion insidieuse du marché.
On peut mettre en perspective le choix du Cigref avec l’élan actuel du “produire français” mais je préfère le rapprocher de la vente de bluekiwi en avril dernier. C’est un signe de plus que les éditeurs français ont beaucoup de mal, d’une part, à lever des fonds, d’autre part, à obtenir la confiance des grands comptes pour des orientations technologiques à l’échelle de l’entreprise. Mais les deux difficultés tirent leur origine de cette idée que les produits conçus en Californie sont meilleurs. Une situation flagrante, par exemple en 2009 et 2010, lorsqu’a plusieurs reprises des grandes entreprises choisissent Sharepoint contre blueKiwi pour bâtir leur réseau social d’entreprise, parfois après avoir fait des expérimentations réussies avec l’éditeur français. Une base irrationnelle qui laisse place ensuite à des éléments qui vont devenir réellement discriminants.
Aujourd’hui l’écart le plus important entre les éditeurs RSE français et américains se trouve dans leur bilan, pas dans leur couverture fonctionnelle. De gros investissements (donc des dettes), de gros chiffres d’affaires, de grosses pertes. Abondamment financées depuis 5 ans, difficile de savoir si elles ont atteint leur point mort. Prenons l’exemple de Yammer (57M$ puis 80M$ en mars 2012) pour se faire racheter 1,2 milliards de dollars par Microsoft. Jive, fin 2011 réalise un CA de 75m$, n’a pas atteint son équilibre, après avoir levé 16,9M$ en 2008, 46,2 en 2010 (http://www.collaboratif-info.fr/actualite/jive-se-prepare-a-une-perilleuse-entree-en-bourse). Jamais profitable en 5 ans nous rappelle Collaboratif-info, avec une perte cumulée de 85M$ à mi-2011. Jive réussi son entrée en bourse mi-décembre 2011 et lève 161,3 m$ supplémentaires. Ces derniers tentent aujourd’hui de transformer un succès dans leur financement en succès populaire, pour escompter un jour un succès commercial.
Les éditeurs français sont, eux, à l’écart du cercle vertueux de la confiance, celle dans la réussite de leur entreprise qui induit celle d’investisseurs, qui conforte les clients qui elle-même est déterminante pour le succès. Or les investisseurs s’assurent de pouvoir sortir avec une plus value, donc de trouver quelqu’un d’autre qui aura confiance dans le succès de l’entreprise. Et la finance a inventé des mécanismes permettant de valoriser une entreprise avant même qu’elle n’ait rencontré le succès commercial. Aucun éditeur du Social Software n’est économiquement viable sauf certains français. Allez-savoir.
Conséquence n°1 : Un dumping économique à peine masqué
Face à ce défi technologique, l’état fait sa part de travail, en soutenant l’innovation avec le CIR et JEI. C’est face au défi commercial que nos éditeurs ne sont pas soutenus. Les grandes entreprises peuvent apporter bien plus qu’un peu de chiffre d’affaire : elles sont un terrain de co-innovation qui apporte maturité et crédibilité à l’éditeur pour affronter ces compétiteurs étrangers. Mais ces entreprises se laissent séduire par les promotions de ces éditeurs américains engagés dans leur phase de conquête visant à capter avant tout des parts de marché : -50%, -75% sur leurs prix publics ne leur font pas peur si le compte est intéressant. Gorgés de capitaux risques, ils peuvent tenir, prendre des positions et attendre que les usages se développent et que leurs solutions s’enracinent chez leurs clients. Ils tablent ensuite sur la paresse des clients à affronter une migration et l’absence de concurrents, tous étouffés par leur stratégie d’occupation. Les grandes entreprises achètent aujourd’hui des solutions vendues à pertes, le réveil n’en sera que plus dur demain. Le savent-elles ?
Conséquence n°2 : Une faible capacité d’investissement pénalisant leur avenir
A cette bataille économique déjà perdue, s’ajoute la conséquence de l’écart de capacité de financement. Les éditeurs financés par du capital risque peuvent non seulement couvrir leurs couts d’exploitation et de commercialisation, mais également investir dans leur technologie plus rapidement que les start-ups en autofinancement. En cela, les éditeurs américains vont également prendre de vitesse les éditeurs français.
Conséquence n°3 : L’absence de levier fourni par des écosystèmes puissants
L’articulation avec les autres applications du SI et les partenariats technologiques seront clefs demain. Ces briques RSE isolées n’ont pas vocation à rester seules, au contraire. (cf. étude sur l’urbanisation du SI Social). Certes les grands éditeurs concernés proposent des Open API, ces API utilisables librement. Dans les faits, il est nécessaire d’être accompagné et donc d’avoir l’approbation et même l’appui de l’éditeur pour que cela fonctionne. Autant dire que pour les petits éditeurs français, cela nécessite un double effort et compromis. Il est par exemple difficile d’intégrer l’écosystème de Microsoft sans l’intégrer à 100% ou de discuter depuis Paris avec les équipes de développeurs de tous les leaders du marché basés en Californie. Leur poids économique et leur proximité leur offrent plus de capacité à fournir un écosystème qui sera demain très discriminant dans l’univers du Saas (On demand, plug & play et dans lequel on tarde à faire de l’intégration).
Le marché du Social Software n’est pas un marché de masse, comme celui de la bureautique ou de la messagerie. Le social business est, on ne cesse de le dire, très imbriqué dans les processus de l’entreprise. Il y aura la même diversité de logiciels dans le marché du Social Software qu’il n’y en a aujourd’hui dans celui du Software. Mais aujourd’hui, les éditeurs leaders sur le marché poussent l’idée qu’il n’y a qu’un seul RSE dans l’entreprise ; une manière de conserver leur position dominante. Les petits éditeurs ont tout intérêt (ainsi que les entreprises) à porter un modèle alternatif, permettant l’interopérabilité. Les éditeurs français doivent sortir de ce jeu dans lequel l’industrie du logiciel les broie.
Certains éditeurs français peuvent devenir des valeurs sures
Les difficultés d’accès à des financements ne les enterrent pas pour autant. Les éditeurs français doivent valoriser d’autres formes d’entrepreneuriats en mesure de renouer avec un autre cercle vertueux de la confiance et revendiquer leur indépendance face à des fonds financiers qui influent sur les stratégies et finissent par faire de l’ingérence. Bien sûr elles doivent être innovantes dans leur offre : une prise de risque plus aisée lorsqu’on est sur un marché de niche, faute de pouvoir attaquer aujourd’hui un marché de masse. Elles peuvent se positionner sur des besoins métiers spécifiques ou répondre aux particularités culturelles des entreprises françaises. Pourquoi les acteurs français ne s’attèleraient pas à fournir des briques articulables entre elles permettant de bâtir le SI social et proposer ainsi un schéma d’architecture alternatif dans lequel ils pourront durablement exister ? et ce, dans l’intérêt des entreprises.
Mais avant tout, elles doivent être plus en phase avec les préceptes portés par leurs produits support de l’Entreprise 2.0. Leurs écosystèmes sont trop pauvres aujourd’hui, et c’est tout juste s’ils s’organisent pour évangéliser leur marché. Pourtant, ils ont peu de chance d’arriver à se développer, seuls. Auront-ils la capacité à développer des synergies de coopétition entre eux pour créer plus de valeur et d’accepter de la partager ?